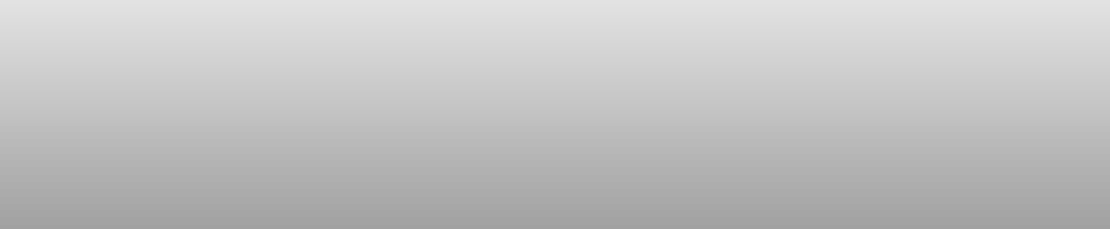
« Et tout le reste n’est rien »
Pour désigner ce roman de plus de mille pages auquel Yves Florenne travailla jusqu’à sa mort, il aimait employer le terme de « saga ». Sur le titre il hésitait entre « Ma vie » puisque le personnage principal y raconte les étapes de son existence, et cet autre titre qu’il a finalement préféré, citation des Lettres d’une religieuse portugaise, texte qu’il aimait et dont il avait donné une édition : « Et tout le reste n’est rien ». Dans ce roman à la première personne, le héros se remémore son enfance, les années de guerre, l’expérience du théâtre, l’histoire enfin d’une passion ultime, pour laquelle l’auteur a préféré la forme d’un roman par lettres. Voici deux textes évoquant la période de la guerre ; le premier, l’arrestation lors d’un passage clandestin ; le second, Paris enfin retrouvé après la Libération.
Réveillé le premier, le passeur alerta son monde. Il s’agissait de partir dans la nuit, pour demeurer invisibles – de qui ? – puisque nous serions encore du bon côté de la ligne ? Le passeur n’observa pas moins que les bas blancs risquaient de nous faire repérer, aggravés par mes culottes de cheval. Or, nous ne passerions qu’après l’entre chien et loup, pour ne nous montrer qu’en plein jour. Tant que subsistait ce qu’on pouvait appeler la nuit, laissé à l’appréciation des rondes, celles-ci tiraient sans sommation. Bref, le soleil brillait, pas plus sur les bas blancs que sur le reste, quand nous avons sauté le pas, notre passeur s’étant borné à nous conduire à la frontière du chemin qui nous mènerait droit à Monceau. Trop droit.
La troupe s’étira, puis se recomposa par petits groupes : le mien comportait la jeune femme et moi. Le chemin n’avait rien d’un sentier caché et peu fréquenté : bien empierré, il était en pleine vue. Je ne voulus pas dire à ma compagne que nous étions partis vers la nasse. Seul, j’aurais tenté de me défiler par les petits jardins des mineurs, en contrebas, mouillés de rosée, qui faisaient à Monceau une banlieue champêtre. Il n’était pas question de lui faire courir ce qui pouvait être un autre risque ; ni, bien entendu, de la planter là. Un peu plus loin une petite grange entr’ouverte, du foin… J’y aurais dormi tranquillement jusqu’à midi, le guet aurait pris fin depuis longtemps, et je n’aurais l’air que d’un promeneur. Mais comment oser proposer ce lit de foin à une telle compagne d’occasion, qui n’était sûrement pas, elle, aguerrie. Je pensais à la jeune femme échouée la nuit à l’hôtel dont je venais de prendre la dernière chambre et qui avait dit bravement : « À la guerre comme à la guerre ! »
Comme à la guerre, où on se laisse piéger. J’apercevais du plus loin le feld-gendarme embusqué : le soleil frappait les lentilles de ses jumelles et l’espèce de croissant de lune blême qu’ils portaient tous sous le col. Autour de lui, là-bas, le petit grouillement noir de ceux qui avaient déjà été cueillis. Pas question de faire demi-tour : même en plein jour, la fuite appelait le tir. Quand nous arrivâmes, sa mine hilare parvint à me réjouir : confortablement embusqué, il n’avait qu’à attendre cette troupe de dupes filant vers lui, chacun avec sa petite valise à la main.
Je pensai amèrement que j’avais moi-même organisé des passages autrement importants par la qualité des passeurs. Le dernier fut aussi un piège, aux conséquences dures et longues, heureusement non tragiques, en ce que personne n’en mourut. La trahison évidente permit de mettre la main sur le passeur vendu. Nous étions encore novices. Cette fois-ci, sans trop d’illusions, je m’étais dit que mieux valait être mêlé à un groupe banal.
[…]
Revoir Paris dans sa liberté ! – Plus encore : dans une pureté inconnue. Que ce fût ou non la première image, c’est celle qui ne me quittera plus : le bouleversant, le miraculeux désert de la Concorde que seule illuminait la lune. Solitude et silence. Pas un corps, mais quelle âme ! En vérité, je ne vis pas une ombre. Comme si j’étais seul. Un survivant. Non : un ressuscité. Désert miraculeux, parce que secrètement habité. Les ombres étaient bien là, ombres anciennes ou d’hier, mais transparentes. On pouvait la regarder aussi comme la plus noble, la plus heureuse des peintures d’architecture, avec marbres et arbres, mais sans ruines. La lumière de la nuit ne révélait même pas les traces, les éclats, ces fraîches blessures aux colonnes que le soleil dénoncerait. Telles qu’à leur naissance, les grandes façades de Gabriel. Pensai-je à une annonciation ? Celle des lendemains de concorde, justement, de justice… Des espérances qui n’étaient pas encore défaites. Une défaite, oui, celle-là. Tout de même restait la liberté, même si déjà on se la disputait, avec le dessein d’en dépouiller tels autres, dont il s’en fallait que tous l’aient mérité. Et puis, qui mérite d’être interdit de liberté ? Pas ceux qui le méditent. Ceux-là, interdits seulement d’asservir.
Non, pour l’heure, cette heure d’une nuit sans autre lumière que celle du dernier ciel d’été, pour l’heure, de ces façades, de ces colonnes d’une pureté presque aussi miraculeuse que si elles étaient grecques, je ne voyais qu’elles, blanches et nues, sans la souillure détestée des drapeaux dont il m’apparaissait soudain que, dans leur gigantisme insultant et dérisoire, ils les avaient presque cachées, leur laissant ce qui pouvait en secret, comme à nous, rester d’heureux.
